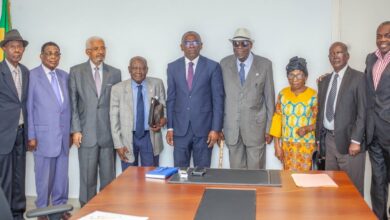Kounabélisme : le poison de la flatterie politique qui gangrène le débat démocratique au Gabon

Dans sa célèbre fable Le Corbeau et le Renard, Jean de La Fontaine mettait en garde contre les effets pervers de la flatterie. Le corbeau, dupé par les compliments du renard, laissa tomber son fromage et perdit tout. Cette leçon vieille de plusieurs siècles résonne tristement dans la vie politique gabonaise, où la pratique du kounabélisme continue de sévir.
Né dans les années 1970 autour du groupe culturel Kounabéli, le kounabélisme s’est mué en véritable culture politique : flatter le chef, chanter ses louanges, exalter ses moindres faits et gestes, non pas par conviction, mais pour obtenir une place, une promotion ou un avantage. Une pratique servile, devenue au fil du temps une seconde nature pour certains acteurs politiques et sociaux.
Les scènes sont connues : chants dithyrambiques en pleine cérémonie, militants transformés en choristes improvisés, étudiants ou associations civiles mobilisés pour entonner des louanges au président du moment. Plus récemment, des partisans n’ont pas hésité à entamer une grève de la faim pour supplier Oligui Nguema de se présenter à une élection. Ces comportements illustrent la persistance d’un culte de la personnalité qui étouffe le débat d’idées. Au lieu de discuter programmes, vision économique ou réformes sociales, le citoyen est invité à applaudir, à acclamer, à répéter des slogans creux.
Le kounabélisme ne relève pas seulement de l’anecdote folklorique. Il est dangereux. Sur le plan politique, il réduit l’espace démocratique à un théâtre où les courtisans rivalisent d’ardeur pour plaire au prince, marginalisant les voix critiques et stérilisant toute contradiction. Sur le plan social, il entretient une hiérarchie artificielle : celui qui flatte accède aux faveurs, celui qui critique est exclu. Sur le plan institutionnel, il nourrit un clientélisme généralisé où loyauté et compétence se mesurent moins aux résultats qu’à la capacité de chanter plus fort que les autres. À terme, c’est l’État lui-même qui s’affaiblit : la médiocrité s’installe, les débats se vident, et les réformes nécessaires sont sacrifiées sur l’autel de la dévotion.
Nombreux sont les observateurs qui appellent à bannir cette pratique. Certains vont plus loin, plaidant pour que le kounabélisme soit puni au même titre que la corruption ou le détournement de fonds publics. Car il s’agit bien d’une forme de corruption : la flatterie servile en échange d’un bénéfice. Une société qui tolère le kounabélisme accepte que l’opportunisme prime sur la vérité, que la flagornerie supplante l’intérêt général. En clair, elle se condamne à revivre éternellement la scène de La Fontaine : le corbeau perd son fromage, et le peuple, son avenir.
Mettre fin au kounabélisme suppose d’abord une prise de conscience collective. C’est à la société civile, aux médias, aux intellectuels et aux jeunes générations de dénoncer ces pratiques et de promouvoir un débat fondé sur les idées et non sur la personne. Les institutions doivent, elles, mettre en place des garde-fous pour sanctionner tout usage abusif du culte de la personnalité. Car une République digne de ce nom ne se construit pas sur les louanges obséquieuses adressées à un individu, mais sur le dialogue critique, la confrontation d’idées et l’exigence de résultats.