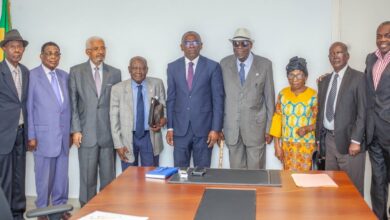Faut-il une police des réseaux sociaux au Gabon ?

Les réseaux sociaux sont devenus au Gabon un formidable espace d’expression, mais aussi un terrain de dérives inquiétantes. Moqueries, harcèlement, diffamation, rumeurs infondées… Ces comportements se multiplient, souvent sans conséquence pour leurs auteurs. Face à ce laisser-aller numérique, l’idée de créer une police des réseaux sociaux, à l’image de la PLCC (Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité) en Côte d’Ivoire, fait son chemin.
Facebook, X (ex-Twitter) Instagram ou TikTok sont devenus le théâtre d’exécutions publiques virtuelles. Sous prétexte d’humour, de “pressing” ou de “buzz”, certains internautes s’adonnent à un véritable lynchage numérique. Des vidéos sont diffusées pour se moquer, des conversations privées exposées pour humilier, et des noms jetés en pâture avant toute preuve. Résultat : des réputations détruites, des familles éclaboussées et parfois des drames humains.
Internet n’est pas un tribunal
Ce déferlement de jugements expéditifs repose sur une dérive inquiétante : la croyance qu’internet peut se substituer à la justice.
Or, la loi est claire. Le Code pénal gabonais punit le harcèlement, la diffamation et les atteintes à la vie privée, y compris lorsqu’ils sont commis en ligne. Internet ne doit donc pas être un espace de non-droit ni un tribunal parallèle où chacun rend sa propre justice.
En cas de litige, le réflexe ne devrait pas être “d’afficher” la personne présumée coupable, mais de s’adresser aux autorités compétentes : police, gendarmerie, parquet. La justice reste le seul cadre légitime pour trancher les contentieux.
Une régulation nécessaire
C’est dans ce contexte qu’une cellule spécialisée de lutte contre la cybercriminalité pourrait jouer un rôle essentiel. À l’image de la PLCC en Côte d’Ivoire, une telle structure permettrait non seulement de traquer les auteurs d’infractions numériques, mais aussi de sensibiliser les citoyens à un usage responsable des réseaux.
L’objectif ne serait pas de restreindre la liberté d’expression, mais de rappeler que cette liberté s’exerce dans le respect de la loi et de la dignité d’autrui.
Un déficit de confiance à combler
Toutefois, il serait réducteur de ne voir dans ces débordements qu’une question de comportement individuel. Ce recours à la “justice numérique” s’explique aussi par le manque de confiance envers les institutions judiciaires et la méconnaissance des procédures à suivre pour obtenir réparation.
Beaucoup de citoyens ignorent vers qui se tourner lorsqu’ils sont victimes d’escroquerie, d’abus ou de harcèlement.
Une meilleure vulgarisation des services judiciaires, par des campagnes d’information, des guichets numériques ou des permanences d’écoute, pourrait rétablir ce lien de confiance. En apprenant aux populations les bons réflexes juridiques, on réduirait naturellement le recours à l’exposition publique sur les réseaux.
Internet est aujourd’hui un miroir de la société : il révèle ses frustrations, ses déséquilibres, mais aussi ses excès. Créer une police des réseaux sociaux ne règlera pas tout, mais elle pourrait rétablir une ligne rouge claire entre la liberté d’expression et la diffamation, entre le débat d’idées et le harcèlement. Parce qu’au fond, la question n’est pas de savoir si nous pouvons tout dire, mais comment dire sans détruire.