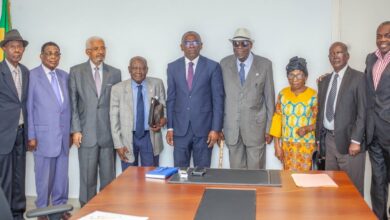Affaire Harold Leckat : quand un contrat devient un crime, la justice gabonaise s’égare

L’incarcération du journaliste Harold Leckat, poursuivi pour détournement de deniers publics à la suite d’un contrat commercial avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), soulève une question de fond : jusqu’où peut aller la justice pénale lorsqu’elle empiète sur le terrain du droit des affaires ? Derrière un contentieux contractuel, c’est la frontière entre le civil et le pénal qui vacille et, avec elle, la confiance dans l’État de droit.
Directeur de publication de Gabon Media Time, Harold Leckat a été arrêté le 15 octobre 2025 à son retour de France, avant d’être placé sous mandat de dépôt le 20 octobre, au terme de cinq jours de garde à vue.
Le parquet lui reproche d’avoir bénéficié d’un contrat de communication signé en 2020 entre sa société et la CDC, requalifié a posteriori en « détournement de deniers publics ».Un chef d’accusation jugé disproportionné par plusieurs organisations professionnelles (Syprocom, Plateforme des Médias Indépendants, RSF, UPF-Gabon) qui dénoncent une « instrumentalisation de la justice ». L’association SOS Prisonniers parle, elle, d’une dérive « anticonstitutionnelle » et rappelle que le journaliste présente toutes les garanties légales de représentation.
Le droit commercial n’est pas du droit pénal
En droit gabonais, comme dans l’espace OHADA, un différend contractuel ne relève pas de la justice pénale. Lorsqu’une entreprise conteste l’exécution ou le paiement d’une prestation, le litige est examiné devant le tribunal de commerce. Les sanctions y sont financières, dommages et intérêts, résiliation, ou exécution forcée, jamais privatives de liberté.
La prison ne s’applique que lorsqu’une infraction est clairement constituée. Le Code pénal gabonais distingue ainsi plusieurs délits :
- L’escroquerie (article 469), fondée sur la tromperie ;l’abus de confiance (article 307), pour un usage détourné de fonds confiés ;
- Le détournement de deniers publics (article 249), qui suppose la qualité d’agent public ;
- L’enrichissement illicite (article 253), réservé aux titulaires d’une fonction publique.
Or, pour qu’il y ait infraction, trois conditions doivent coexister : une loi violée, un acte matériel prouvé, et une intention frauduleuse manifeste. À défaut, la privation de liberté devient arbitraire.
Un contrat civil maquillé en faute pénale ?
Dans le cas présent, le contrat en cause liait deux sociétés légalement établies, exécuté plusieurs années durant et reconduit jusqu’en 2023. Même la nouvelle direction de la CDC aurait maintenu la collaboration durant six mois avant de la remettre en cause.Pour de nombreux juristes, dont le Dr Ali Akbar Onanga Y’Obegue, la qualification de « détournement de deniers publics » apparaît infondée. Harold Leckat n’était ni gestionnaire de fonds publics, ni agent de l’État.
Une éventuelle absence de mise en concurrence, si elle était démontrée, relèverait du droit de la commande publique, une irrégularité administrative passible de sanctions civiles, non d’une incrimination pénale, en l’absence de manœuvres frauduleuses.
Quant aux notions d’escroquerie ou d’abus de confiance, elles supposent la remise d’une somme à charge d’un usage précis et la preuve d’une intention trompeuse, ce qu’aucun élément public de l’enquête ne semble établir. En l’état, l’affaire s’apparente donc davantage à un litige commercial qu’à une infraction pénale.
Un précédent inquiétant pour l’État de droit et la presse
L’usage du pénal pour trancher un désaccord contractuel constitue un dangereux précédent. Il expose les entrepreneurs à la peur de contracter librement et installe un climat d’intimidation vis-à-vis de la presse, surtout lorsqu’elle dérange.
Les organisations professionnelles l’affirment : s’il y a litige, le juge compétent est celui du commerce, non celui du pénal. Et la liberté d’informer se protège par la transparence des procédures, pas par la détention préventive.
En définitive, la demande de mise en liberté provisoire d’Harold Leckat s’inscrit pleinement dans l’esprit du droit des affaires, fondé sur la proportion et la bonne foi. L’affaire dira si le Gabon choisit de consolider son État de droit, ou de laisser la justice commerciale se dissoudre dans la logique du soupçon.