Projet de loi de finances 2026 : une nouvelle taxe d’habitation au programme
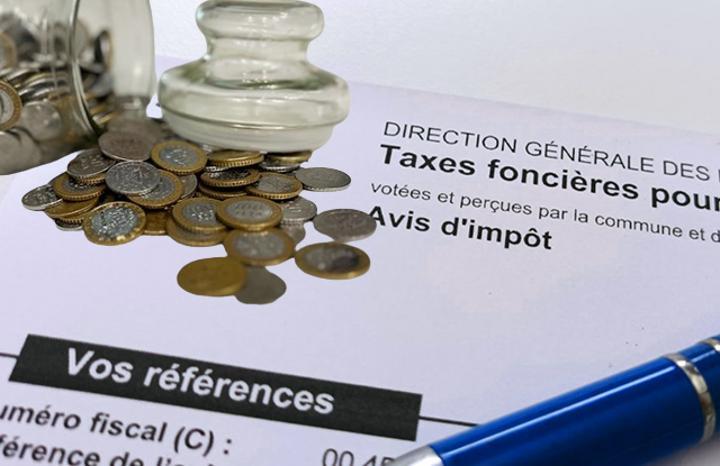
En cours d’examen au Parlement, le projet de loi de finances 2026 introduit plusieurs mesures budgétaires issues du dernier Conseil des ministres présidé par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguéma. Parmi les principales nouveautés figure la création d’une taxe d’habitation.
Cette taxe concernera l’ensemble des ménages, mais son application sera modulée en fonction des revenus. Le gouvernement précise que les foyers aux ressources les plus modestes bénéficieront de mécanismes allégés afin de préserver l’équité fiscale. L’objectif affiché est double : renforcer les recettes publiques tout en répartissant l’effort de manière proportionnée.
Selon l’exécutif, cette réforme doit permettre à l’État de mieux mobiliser ses ressources, de respecter ses engagements financiers et de dégager des marges supplémentaires pour financer les projets de développement.
Autre changement notable : les taxes municipales et communautaires ne seront plus collectées de manière dispersée. Elles devront désormais être versées directement au Trésor public, une centralisation présentée comme un gage de transparence et de bonne gestion.
Le gouvernement mise également sur la digitalisation des services fiscaux et la modernisation des procédures de collecte. Ces évolutions visent à simplifier le paiement des impôts pour les contribuables tout en améliorant l’efficacité de l’administration.
Avec cet ensemble de mesures, l’exécutif entend bâtir un budget « lisible et opérationnel », reposant sur des sources de financement diversifiées et mieux adaptées aux priorités nationales.
Une réforme nécessaire mais délicate dans le contexte gabonais
Si la création d’une taxe d’habitation répond à un besoin évident de renforcer les finances publiques, son acceptabilité sociale risque de poser problème. Dans un contexte marqué par un pouvoir d’achat fragile, un chômage élevé et des inégalités persistantes, de nombreux ménages pourraient percevoir cette nouvelle charge comme une contrainte supplémentaire. L’efficacité de la mesure dépendra donc de sa capacité à être appliquée avec équité, notamment à travers des dispositifs réellement protecteurs pour les plus modestes.
Par ailleurs, la centralisation des taxes locales, bien que justifiée par un souci de transparence, pourrait susciter des tensions avec certaines collectivités, qui craignent une perte d’autonomie financière. La réussite de cette réforme passera alors par un équilibre entre contrôle de l’État et responsabilisation des administrations locales.
Enfin, la digitalisation des procédures fiscales, présentée comme une avancée, se heurtera aux réalités du terrain : faible accès à Internet dans certaines zones, manque de maîtrise des outils numériques et insuffisance de l’accompagnement des usagers. Sans une véritable politique d’inclusion numérique, cette modernisation risque de creuser encore plus les inégalités entre contribuables.
En somme, la taxe d’habitation et les réformes associées traduisent une volonté de moderniser et de sécuriser les finances publiques. Mais leur réussite dépendra de la capacité du gouvernement à concilier rigueur budgétaire, justice sociale et inclusion, dans un pays où la défiance fiscale reste forte et où l’adhésion des citoyens sera déterminante.




